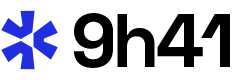Lors d’une audition officielle devant le Sénat français, Microsoft France a reconnu ne pas pouvoir garantir la protection totale des données européennes face à de potentielles requêtes du gouvernement américain. Cette déclaration met en lumière les défis majeurs liés à la souveraineté numérique européenne et souligne les problématiques posées par la législation extraterritoriale américaine sur le cloud et les flux transatlantiques de données.
Un aveu inédit lors d’une audition au Sénat
Le 12 mars 2025, Anton Carniaux, directeur juridique de Microsoft France, a affirmé sous serment l’incapacité de son entreprise à protéger intégralement les données hébergées sur ses infrastructures cloud contre toute demande émanant des autorités américaines. Selon ses propos, ni la localisation physique des serveurs ni l’ensemble des mesures contractuelles mises en œuvre jusqu’ici ne suffisent à garantir la totale inviolabilité des données européennes face au droit américain.
Cette intervention intervient dans un contexte où la commande publique française accorde une importance croissante aux questions de sécurité et de respect des cadres juridiques européens. Les auditions menées par le Sénat témoignent d’une vigilance accrue quant à l’utilisation de solutions étrangères pour des services critiques ou réglementés, notamment via le recours massif au cloud computing.
Qu’impliquent juridiquement les lois américaines sur les fournisseurs cloud ?
L’aveu de Microsoft est directement lié à l’existence de textes comme le Cloud Act, adopté aux États-Unis en 2018. Ce dispositif confère aux agences fédérales le pouvoir d’exiger l’accès à des données détenues par n’importe quelle entreprise assujettie au droit américain, même lorsque ces informations résident hors du territoire national. En pratique, cela concerne tous les géants technologiques ayant leur siège social outre-Atlantique, dont Microsoft, Amazon et Google font partie.
Les responsables européens avaient déjà exprimé leur inquiétude quant à la portée extraterritoriale de telles lois. Malgré la mise en place récente du Data Privacy Framework visant à sécuriser légalement les transferts de données entre l’Union européenne et les États-Unis, les marges de manœuvre pour se prémunir de demandes administratives américaines restent limitées. Ce constat fragilise la confiance envers certains prestataires cloud utilisés dans le secteur public et privé en Europe.
- 🔒 Cloud Act : permet aux autorités américaines d’exiger des données, peu importe leur localisation géographique
- 🌐 Data Privacy Framework : accord-cadre jugé insuffisant par plusieurs experts européens
- 🇪🇺 Risque de remise en cause de la souveraineté numérique des États membres de l’UE
Quels secteurs publics sont concernés par ces limitations ?
De nombreux organismes publics français – ministères, universités, collectivités locales – ont investi massivement dans la modernisation de leurs systèmes d’information, souvent via le recours à des outils proposés par Microsoft 365. Ces plateformes englobent la gestion de messageries électroniques, d’espaces collaboratifs et de bases de données sensibles. Or, l’aveu formulé devant le Sénat interroge la stratégie d’externalisation des données de ces acteurs, en particulier ceux opérant sur des missions dites « régaliennes » ou sur des secrets protégés.
Le débat s’anime également autour des marchés publics numériques, dont les dispositifs doivent impérativement intégrer la question de la souveraineté et de la résilience informatique. Les auditions successives évoquées par la direction générale de Polytechnique confirment cette préoccupation chez différents ordonnateurs publics lors du choix de leurs prestataires informatiques. Une attention particulière est donnée aux clauses de localisation des données et aux certifications de sécurité.
| 🏛️ Secteur | 📊 Usage principal | 🚨 Données sensibles concernées |
|---|---|---|
| Administration centrale | Gestion RH, correspondances internes | Informations personnelles, fichiers stratégiques |
| Éducation supérieure | Espaces de stockage pédagogique, notes, examens | Dossiers étudiants, travaux de recherche |
| Collectivités territoriales | Schémas directeurs SI, dématérialisation des procédures | Bases d’état civil, documents urbanismes |
Quelles conséquences pour les échanges transatlantiques ?
La viabilité du Data Privacy Framework, conçu pour encadrer rigoureusement les transferts de données entre l’Europe et les États-Unis, se retrouve aujourd’hui fragilisée. Récemment, le Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) a connu des remous institutionnels qui mettent en doute la pérennité de cet accord. Ces incertitudes génèrent des difficultés concrètes pour les sociétés européennes souhaitant collaborer avec des partenaires américains tout en assurant le respect du RGPD.
Pour les entreprises privées, des risques opérationnels apparaissent également. À défaut de garanties solides, certaines organisations se tournent vers des solutions européennes alternatives censées mieux répondre aux exigences de confidentialité fixées par la réglementation locale. Le marché du cloud souverain tente ainsi de gagner du terrain, même si son adoption reste nuancée du fait de la maturité technique, de l’interopérabilité ou du coût.
- ⚖️ Incertitude juridique persistante sur les transferts de données UE-USA
- 💼 Adaptations nécessaires des stratégies de mise en conformité pour les DSI
- 🆕 Montée en puissance des offres de cloud souverain européen
Comment les institutions réagissent-elles face à ce constat ?
Du côté européen, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer la révision des cahiers des charges liés aux appels d’offres informatiques. Certaines administrations envisagent de renforcer leurs exigences sur la localisation physique des serveurs et de privilégier des prestataires exclusivement soumis au droit européen. Des discussions sont également engagées afin d’améliorer la transparence contractuelle et d’augmenter les contrôles sur les accès potentiels aux données stockées hors d’Europe.
Au sein des instances nationales, le débat se concentre aussi sur l’accompagnement des entités publiques dans le choix de solutions cloud de confiance. La CNIL, en collaboration avec l’ANSSI, documente régulièrement les bonnes pratiques et encourage la création d’un écosystème local moins dépendant des acteurs étrangers dominants. Pour de nombreux décideurs, il s’agit désormais d’évaluer chaque compromis entre innovation, accessibilité et contrôle réel sur la donnée.
Vers une refonte des pratiques d’achat public ?
Plusieurs groupes parlementaires recommandent d’inclure systématiquement, dans les appels d’offres publics, des critères relatifs à la souveraineté numérique et à la gestion des risques liés à l’extraterritorialité. Les auditions menées ces derniers mois montrent une volonté de faire évoluer la réglementation afin d’établir un équilibre réaliste entre ouverture internationale et garantie de la sécurité des informations.
Face à ces enjeux, l’idée d’imposer de nouveaux standards techniques et de favoriser le développement de solutions natives prend de l’ampleur. Même si la route s’annonce longue, la dynamique enclenchée traduit une prise de conscience renouvelée sur le plan stratégique.
L’avenir des relations Europe–États-Unis en matière de données
Les prochaines années devraient être décisives pour la définition de nouveaux accords transatlantiques. L’évolution des législations américaines, les décisions de justice européennes concernant l’adéquation des protections garanties, ainsi que la pression citoyenne pour davantage de transparence, façonneront l’écosystème international de la donnée.
En parallèle, les administrations européennes suivront de près les initiatives portées par des consortiums locaux ou des coalitions dédiées à la souveraineté numérique, tout en visant un meilleur alignement entre innovation technologique et préservation des droits fondamentaux.